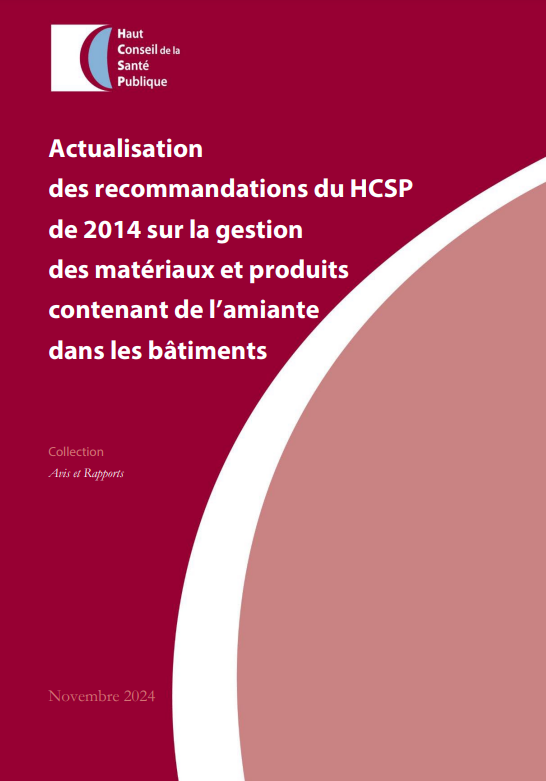Nouveaux avis du Haut Conseil de la Santé Publique : une révolution pour la gestion de l'amiante ?
Le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) vient de publier deux documents actualisant et ajoutant des recommandations pour mieux gérer l'amiante en France. Certaines de ces recommandations sont déjà appliquées.
Le 4 février 2025
Nouveaux avis du Haut Conseil de la Santé Publique sur la gestion de l'amiante (novembre 2024) : une révolution ?
Le HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) vient de publier deux documents actualisant et ajoutant des recommandations pour mieux gérer l'amiante en France. Certaines de ces recommandations sont déjà appliquées.
1. Synthèse du document "Avis du HCSP sur l’amiante dans les bâtiments"
Contexte et Objectifs
Ce document actualise les recommandations du HCSP sur la gestion de l’amiante dans les bâtiments, les dernières datant de 2014. Il évalue la mise en œuvre des recommandations de 2014 et propose des ajustements pour améliorer la gestion des matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA)
Principales recommandations
- Abaissement du seuil d’empoussièrement : Réduction de la valeur de déclenchement des travaux à 2 fibres/litre (f/L) pour mieux prévenir les expositions
- Création de Comités Techniques Régionaux Amiante : Instances dédiées au traitement des cas complexes et à la coordination des acteurs régionaux.
- Interopérabilité des bases de données : Harmonisation et interconnexion des outils (SI-Amiante, DEMAT@miante, Trackdéchets) pour un suivi plus efficace des MPCA
- Surveillance sanitaire : Maintien et extension du programme national de surveillance du mésothéliome, avec un suivi accru des expositions environnementales et extra-professionnelles
- Renforcement des sanctions : Instauration de mesures coercitives pour garantir le respect des réglementations par les propriétaires et gestionnaires de bâtiments.
Implications pour les professionnels
D'après le HCSP, les diagnostiqueurs, maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux doivent intégrer ces nouvelles exigences dans leurs processus de gestion et d’intervention sur les MPCA.
2. Synthèse du document "Gestion des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les bâtiments"
Contexte et Objectifs
Ce document propose une analyse détaillée des étapes de gestion des MPCA, en intégrant des recommandations actualisées basées sur l’état des lieux réglementaire et technique.
Principaux axes de gestion des MPCA
- Identification et repérage :
- Renforcement des obligations de repérage avant travaux.
- Certification et formation accrue des diagnostiqueurs
- Travaux de gestion de l’amiante :
- Révision des seuils d’intervention avec une application des mesures strictes dès 2 f/L.
- Évaluation systématique des méthodes d’intervention pour limiter l’émission de fibres
- Gestion des déchets amiantés :
- Définition de protocoles plus stricts pour la manipulation, le transport et l’enfouissement des déchets.
- Recherche d’alternatives à l’enfouissement via l’inertage chimique
- Surveillance et évaluation des impacts :
- Suivi renforcé des expositions résidentielles et professionnelles.
- Surveillance environnementale des zones exposées aux MPCA
Implications pour les professionnels
D'après le HCSP, les entreprises de désamiantage devront adapter leurs pratiques aux nouvelles exigences, notamment en ce qui concerne la traçabilité et la gestion des déchets.
Conclusion
Ces deux documents se complètent :
- L’avis du HCSP apporte un cadre réglementaire révisé, en insistant sur la gouvernance et les seuils réglementaires.
- Le rapport sur la gestion des MPCA précise les modalités techniques de mise en conformité et les méthodes opérationnelles à appliquer.
- Le renforcement des exigences en matière de repérage et de certification est un levier clé pour fiabiliser la détection de l’amiante et éviter les expositions accidentelles.
Avec la mise à jour de ces recommandations, d'après la HCSP, la filière du diagnostic immobilier devra s’adapter rapidement aux nouvelles contraintes pour garantir une meilleure gestion du risque amiante.
Focus 1 : Recommandations sur le repérage et la certification des opérateurs de repérage
Le repérage de l’amiante est une étape cruciale dans la prévention des risques liés aux MPCA (Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante). Le HCSP met en avant plusieurs recommandations pour garantir la qualité et la fiabilité des diagnostics, renforcer le cadre réglementaire et améliorer la traçabilité des repérages. Certaines sont déjà appliquées.
1. Renforcement des exigences de certification et de formation des opérateurs
Le HCSP insiste sur la nécessité d’élever le niveau de compétence des opérateurs de repérage amiante à travers :
a) Une formation renforcée et plus spécialisée
- Augmenter la durée et le contenu des formations pour inclure :
- Les nouvelles techniques d’identification des MPCA.
- Une meilleure compréhension des risques liés aux fibres d’amiante courtes et aux Particules Minérales Allongées d’intérêt (PMAi).
- L’apprentissage des méthodes de microscopie électronique à transmission analytique (META) pour détecter les fibres d’amiante non visibles en microscopie optique.
- Intégration de formations pratiques en laboratoire et sur site, avec des études de cas réels.
b) Certification plus exigeante et contrôlée
- Évaluation régulière des opérateurs par des tests pratiques et théoriques (augmentation de la fréquence des CSO - Contrôles Sur Ouvrage).
- Recertification obligatoire tous les cinq ans avec mise à jour sur les évolutions réglementaires et techniques.
- Création d’un registre national des opérateurs certifiés pour permettre aux donneurs d’ordre d’identifier des professionnels qualifiés.
2. Harmonisation des méthodes de repérage et des protocoles
Le HCSP souligne l’importance d’une méthodologie standardisée pour limiter les écarts de diagnostic entre différents opérateurs.
a) Généralisation des protocoles et des techniques d’investigation
- Obligation pour tous les opérateurs d’utiliser un protocole standardisé dans le cadre des repérages avant travaux et avant démolition.
- Recours obligatoire à des laboratoires accrédités pour l’analyse des échantillons.
- Utilisation de la microscopie électronique à transmission analytique (META) pour toutes les analyses de prélèvement, au lieu de la microscopie optique à lumière polarisée (MOLP), moins précise.
b) Augmentation du nombre de prélèvements par bâtiment
- Établissement d’un nombre minimal de prélèvements en fonction de la superficie et de la typologie des bâtiments pour éviter les diagnostics incomplets.
- Obligation d’effectuer un repérage destructif lorsque les matériaux ne sont pas accessibles à l’œil nu, notamment avant des travaux lourds de rénovation.
3. Traçabilité et centralisation des données
a) Dépôt obligatoire des rapports de repérage dans une base nationale
- Mise en place d’un enregistrement systématique des repérages sur la plateforme SI-Amiante.
- Accès partagé entre les opérateurs, les maîtres d’ouvrage et les organismes de contrôle.
b) Identification et suivi des bâtiments amiantés
- Création d’une base de données publique recensant les bâtiments contenant de l’amiante, accessible aux futurs acquéreurs, gestionnaires et locataires.
- Obligation pour les propriétaires de mettre à jour le Dossier Technique Amiante (DTA) après chaque repérage ou intervention sur les MPCA.
4. Responsabilisation des donneurs d’ordre et sanctions accrues
a) Engagement des maîtres d’ouvrage et des entreprises de travaux
- Obligation pour tout maître d’ouvrage de choisir un opérateur certifié et indépendant avant d’engager des travaux.
- Contrôle des rapports de repérage par des auditeurs externes pour éviter les erreurs ou omissions volontaires.
b) Sanctions pour non-conformité
- Instauration de pénalités financières en cas d’absence ou d’insuffisance de repérage avant travaux.
- Suspension de certification en cas de faute grave d’un opérateur de repérage (omission de MPCA, diagnostic erroné volontaire).
5. Sensibilisation et formation des acteurs du bâtiment
a) Campagnes d’information pour les professionnels et les particuliers
- Création d’un guide national de bonnes pratiques pour les entreprises de travaux et les maîtres d’ouvrage.
- Sensibilisation des particuliers sur les dangers liés aux MPCA et leurs obligations en cas de travaux.
b) Formation des artisans et intervenants du BTP
- Renforcement des formations obligatoires SS4 (Sous-section 4) pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante.
- Certification obligatoire pour les électriciens, plombiers, peintres et autres artisans intervenant sur des bâtiments construits avant 1997.
Conclusion
Les nouvelles recommandations du HCSP marquent une évolution importante dans la gestion du repérage de l’amiante en France. Elles visent à améliorer la fiabilité des diagnostics, renforcer la formation des opérateurs et garantir une meilleure traçabilité des bâtiments amiantés.
Synthèse des actions clés à retenir :
- Certification renforcée et recertification obligatoire tous les 5 ans.
- Uniformisation des protocoles de repérage avec plus de prélèvements obligatoires.
- Enregistrement systématique des repérages dans SI-Amiante.
- Renforcement des sanctions en cas de manquements.
- Sensibilisation des maîtres d’ouvrage et formation accrue des artisans du BTP.
Ces évolutions imposeraient aux opérateurs de repérage et aux professionnels du bâtiment une mise à niveau rapide de leurs pratiques pour assurer une meilleure protection des travailleurs et du public contre les risques liés à l’amiante.
Le détail des recommandations - Synthèse des recommandations sur le repérage et la certification des opérateurs de repérage (R 2024 n°6 & R 2024 n°7)
Focus 2 : Recommandations Générales
Le HCSP propose plusieurs recommandations visant à améliorer la prévention des risques liés à l’amiante dans tous les secteurs concernés.
1. Gouvernance et réglementation
- Harmonisation des réglementations nationales et locales pour éviter les écarts d’application.
- Création d’un référentiel unique intégrant toutes les obligations liées à la gestion de l’amiante, pour les diagnostiqueurs, maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux.
- Renforcement des contrôles des chantiers par les inspections du travail et les DREAL.
2. Sensibilisation et formation
- Intégration d’un module amiante obligatoire dans les formations des professionnels du bâtiment.
- Campagne nationale de communication sur les dangers de l’amiante et les obligations réglementaires.
Focus 3 : Recommandations sur les analyses et mesures
Le HCSP met en avant des recommandations pour améliorer la fiabilité des analyses et limiter l’exposition aux fibres d’amiante.
1. Renforcement des techniques d’analyse
- Généralisation de la microscopie électronique à transmission analytique (META) pour remplacer la microscopie optique (MOLP), moins précise.
- Mise en place d’un référentiel qualité unique pour les laboratoires effectuant des analyses amiante.
- Obligation de contre-expertise en cas de doute sur un diagnostic.
2. Surveillance et mesure des fibres dans l’air
- Abaissement du seuil réglementaire d’empoussièrement à 2 fibres/litre.
- Mise en place d’un réseau de surveillance environnementale des niveaux d’amiante dans l’air extérieur.
- Création d’un indice de pollution amiante atmosphérique, basé sur des mesures périodiques en zones urbaines et industrielles.
Focus 4 : Prise en compte des sources extérieures d’amiante (affleurements naturels, chantiers, anciens sites industriels)
Le HCSP recommande de renforcer la surveillance des zones où l’amiante est naturellement présent ou a été dispersé par des activités humaines.
1. Surveillance des affleurements naturels
- Création d’une cartographie des zones à risque, où des affleurements naturels d’amiante sont présents (notamment en Corse et dans certaines régions montagneuses).
- Mise en place d’un protocole de gestion spécifique pour les travaux réalisés dans ces zones.
2. Gestion des chantiers et anciens sites industriels
- Renforcement des diagnostics amiante avant toute reconversion de site industriel.
- Obligation de dépollution complète avant tout changement d’usage d’un site (ex : transformation d’une friche industrielle en zone résidentielle).
- Mise en place de zones tampon autour des sites en cours de désamiantage pour éviter la dispersion des fibres.
3. Renforcement des contrôles en zones à risque
- Surveillance accrue des niveaux d’amiante dans l’air autour des carrières, sites industriels désaffectés et chantiers de grande ampleur.
- Renforcement de la réglementation pour l’utilisation de matériaux extraits de carrières en zones à risque d’amiante naturel.
Focus 5 : Recommandations sur les déchets amiantés
La gestion des déchets amiantés est un enjeu majeur pour réduire les expositions accidentelles et limiter l’impact environnemental.
1. Amélioration des filières de collecte et de traitement
- Développement des lieux d’apport volontaire sécurisés pour les particuliers et artisans.
- Généralisation des filières spécialisées de traitement, avec des plateformes dédiées pour l’inertage des déchets amiantés.
2. Renforcement des mesures de traçabilité
- Mise en place d’un suivi numérique des déchets amiantés, via la plateforme Trackdéchets.
- Obligation pour chaque chantier d’amiante de fournir une preuve de traitement final des déchets.
3. Encouragement aux alternatives à l’enfouissement
- Développement de solutions d’inertage chimique et thermique pour éviter l’enfouissement systématique.
- Financement de recherches sur le recyclage sécurisé des matériaux contenant de l’amiante.
4. Sanctions et contrôles
- Sanctions renforcées en cas d’abandon illégal de déchets amiantés.
- Inspections renforcées sur les chantiers de désamiantage pour vérifier la bonne gestion des déchets.
Pour bénéficier de notre veille réglementaire et normative, nous consulter.
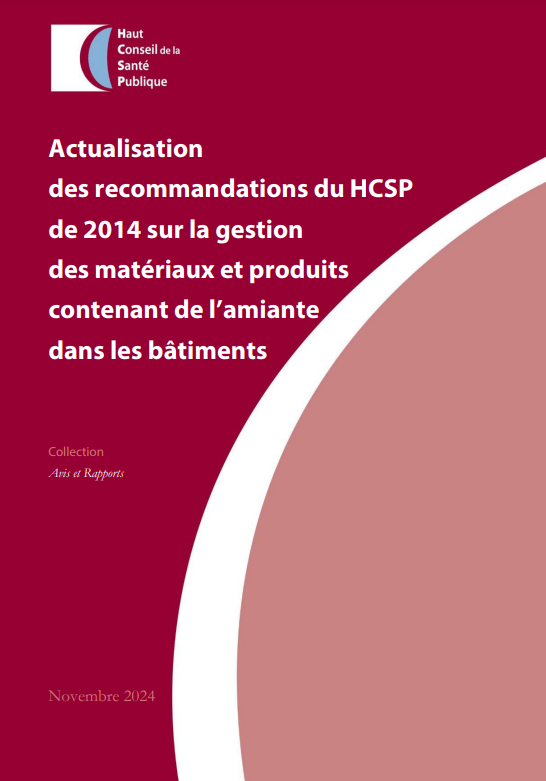
Management
du risque sanitaire
Parce que le pire est prévisible,
nous vous préparons pour le meilleur.

 France
France Espagne
Espagne