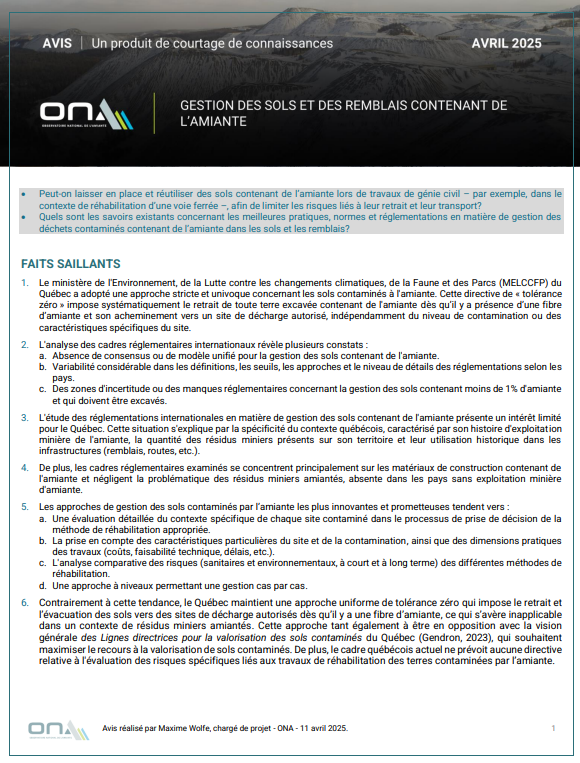Retour d'expériences : excavation des terres contenant de l'amiante (Canada)
Comme le rappelle la dernière note d'avril 2025 de l'Observatoire National de l'Amiante, le cadre actuel de gestion des sols contaminés à l’amiante au Québec repose sur une logique de tolérance zéro : toute terre excavée contenant ne serait-ce qu’une fibre d’amiante doit être retirée et envoyée vers un site de décharge autorisé. Cette approche, bien que prudente sur le plan sanitaire, engendre des coûts élevés, des délais importants et des risques accrus lors de la manipulation et du transport de ces matériaux.
Le 25 avril 2025
Réutilisation des sols contaminés à l’amiante : vers une révision des pratiques au Québec ?
Temps de lecture : 6 min
Catégorie : réglementation internationale, technique
Un cadre réglementaire québécois sous tension
Comme le rappelle la dernière note d'avril 2025 de l'Observatoire National de l'Amiante, le cadre actuel de gestion des sols contaminés à l’amiante au Québec repose sur une logique de tolérance zéro : toute terre excavée contenant ne serait-ce qu’une fibre d’amiante doit être retirée et envoyée vers un site de décharge autorisé. Cette approche, bien que prudente sur le plan sanitaire, engendre des coûts élevés, des délais importants et des risques accrus lors de la manipulation et du transport de ces matériaux.
Ce modèle est particulièrement inadapté aux régions québécoises historiquement marquées par l’exploitation de l’amiante, comme Thetford Mines, où l’amiante est présent dans 90 % des excavations. Dans un tel contexte, la décontamination systématique est jugée irréaliste.
Des alternatives internationales plus souples et adaptées
L’analyse comparative des réglementations internationales montre une grande variabilité dans la définition et la gestion des sols amiantés. Des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Belgique ou les Pays-Bas ont mis en place des systèmes de classification fondés sur la concentration en fibres d’amiante dans le sol, permettant une gestion par niveaux.
Certaines pratiques innovantes incluent :
-
La réutilisation contrôlée sur site avec confinement,
-
Le prétraitement sur site pour réduire le volume de matériaux à évacuer,
-
L’élaboration de modèles conceptuels de site pour guider les décisions.
Ces approches s’appuient sur une évaluation contextuelle des risques, favorisant une réhabilitation durable, techniquement faisable et économiquement rationnelle.
Une évolution nécessaire du modèle québécois
Le rapport de l’Observatoire national de l’amiante (ONA) recommande une évolution du cadre réglementaire québécois vers une approche plus flexible, tenant compte :
-
Du contexte historique et géologique (ex. : résidus miniers amiantés),
-
Des caractéristiques spécifiques de chaque site,
-
D’une analyse des risques sanitaire et environnemental,
-
De la durabilité et du rapport coût-bénéfice des solutions envisagées.
Cette approche pourrait s’inspirer des normes australiennes et néo-zélandaises de gestion des risques (AS/NZS 4360:2004), en intégrant un organigramme décisionnel pour sélectionner la méthode de réhabilitation la plus adaptée.
Exemple concret : la route 112 à Thetford Mines
Le projet de relocalisation de la route 112 illustre les défis techniques et réglementaires liés à la gestion des sols amiantés. Exempté de l’évaluation environnementale, ce chantier a nécessité la manipulation de 1,5 million de m³ de résidus amiantés, avec une végétalisation des talus comme solution de confinement. Le succès du projet, salué par un prix d’ingénierie en 2019, démontre la faisabilité d’approches contextualisées, même dans un environnement fortement contaminé.
Conclusion : une opportunité d’adaptation
Face aux limites du modèle québécois actuel, l'Observatoire National de l'Amiante indique qu'une révision s’impose pour permettre une gestion plus efficiente, sécuritaire et durable des sols contaminés par l’amiante. Cela implique notamment une reconnaissance de la complexité des contextes locaux, et l’adoption d’une stratégie réglementaire fondée sur le risque, et non sur le seul principe de précaution.
Source : Avis réalisé par Maxime Wolfe, Observatoire national de l’amiante (ONA), 11 avril 2025
Pour en savoir plus et bénéficier de notre veille réglementaire et normative, nous consulter.
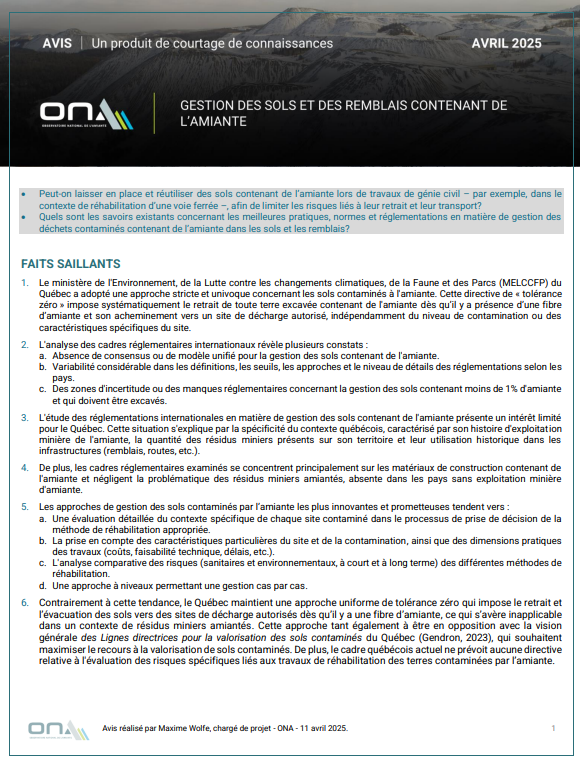
Management
du risque sanitaire
Parce que le pire est prévisible,
nous vous préparons pour le meilleur.

 France
France Espagne
Espagne